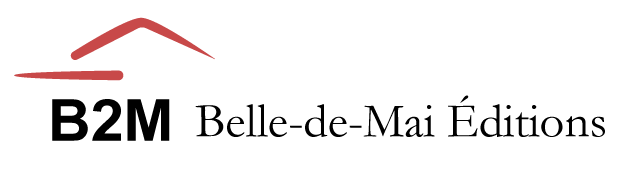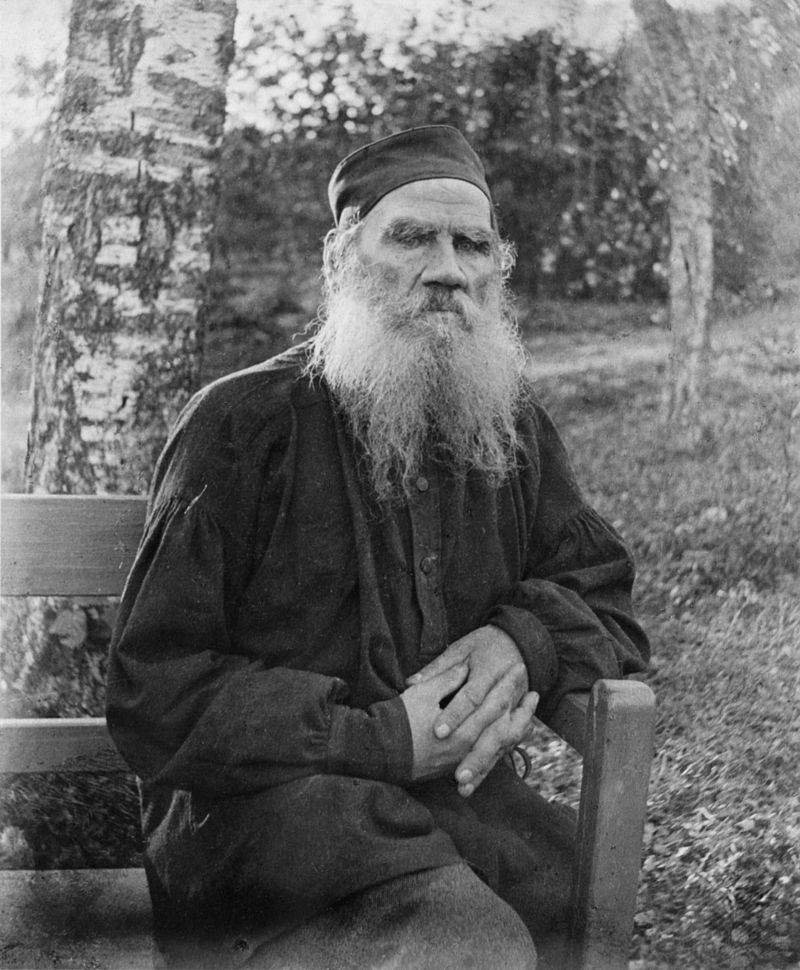À l’été 2020, il n’y avait pas que le Tenet de Christopher Nolan à voir au cinéma. Il y avait aussi Malmkrog, du réalisateur roumain Cristi Puiu. Ce dernier proposait avec ce film exigeant une adaptation réussie du livre Trois entretiens sur la guerre, la morale et la religion du philosophe russe Vladimir Soloviev. Dans cet ouvrage, récemment réédité pat les éditions B2M, le philosophe se pose une question qui l’a hanté toute sa vie : qui est l’Antéchrist ?
Le règne en Russie du Tsar saint Nicolas II (1894-1917) fut un moment d’intenses bouleversements politiques et culturels. De nombreux mouvements contradictoires animaient alors l’empire. L’un de ces mouvements a reçu a posteriori le nom de Renaissance Religieuse Russe. Par ce terme, les historiens désignent un mouvement de retour (souvent rempli d’ambigüités cependant) à l’Orthodoxie de certains membres de l’intelligentsia révolutionnaire. Ce mouvement concerna tant des philosophes (par exemple Serge Boulgakov ou Nicolas Berdiaev) que des artistes (par exemple Dimitri Merejkovski ou Alexandre Blok). Le philosophe et poète Vladimir Soloviev (1853-1900) peut, à bien des égards, être considéré comme l’inspirateur de cette Renaissance Religieuse Russe (ceux que le sujet intéresse pourront entre autres lire The Russian Religious Renaissance in the twentieth century de l’historien russo-américain Nicolas Zernov).
Si l’œuvre de Soloviev inspira ainsi toute une génération de penseurs et d’artistes, elle lui était cependant trop profondément personnelle pour véritablement faire école. Celle-ci constituait en effet une synthèse parfois étrange, et qui plus est évolutive, de slavophilisme orthodoxe, d’occidentalisme catholique, de socialisme, de théosophie, de gnosticisme, de kabbale juive et d’idéalisme allemand, unifiée par l’immense génie de son auteur, souvent guidé par ses propres visions mystiques. On peut néanmoins discerner au fondement de la pensée de Soloviev une intuition directrice : la transfiguration divine du monde s’accomplira par l’incarnation cosmique d’un être de beauté, l’Éternel Féminin, qu’il appelle la Sophia et dont il aurait eu une vision une nuit de 1875, aux pieds des pyramides d’Égypte. Pour Soloviev, comme pour Dostoïevski, dont il fut d’ailleurs un ami intime (le personnage d’Aliocha Karamazov serait inspiré du jeune Soloviev), c’est donc bien la beauté qui doit sauver le monde. Dans son livre Vladimir Soloviev et son œuvre messianique, Dimitri Strémoukoff analyse comment Soloviev a exploré cette intuition à travers les trois périodes successives de son œuvre : dans la pensée (période théosophique), dans la politique (période théocratique), dans l’art (période théurgique).
Alain Besançon, dans son livre La falsification du bien (où il propose une intéressante lecture croisée de Soloviev et de George Orwell), relève que malgré l’éclectisme de ses sources, Soloviev est toujours resté enraciné dans la christologie traditionnelle de l’Orient, en particulier dans celle de saint Maxime le Confesseur, pour laquelle la déification de l’homme et du monde s’accomplit toujours par la coopération de la grâce divine et de la liberté humaine. L’activité de l’homme a ainsi à ses yeux un rôle nodal à jouer dans le salut du monde. Cependant, au cours de sa vie, il devient de plus en plus pessimiste. Il se rend peu à peu compte que l’œuvre divino-humaine d’incarnation de la Sophia se heurte à des oppositions difficilement surmontables. La réalité du mal prend ainsi de plus en plus de place dans sa vision du monde. En 1898, une vision qu’il aurait eue du diable achève de le convaincre de la puissance des forces démoniaques à l’œuvre dans l’histoire. Son dernier livre, paru en 1899, vise ainsi à démasquer la nature de l’agent ultime des forces du mal : l’Antéchrist. Influencé par sa lecture de Platon, il décide de donner à ce livre la forme d’un dialogue, qu’il intitule Trois entretiens sur la guerre, la morale et la religion.
Discussion de salon
Dans une villa sur la côte d’Azur, une dame de la haute société russe tient salon. Elle accueille ainsi quatre invités : le général, l’homme politique, le prince, et Monsieur Z, qui n’est autre que Soloviev lui-même. Le dialogue commence lorsque le général remarque qu’autrefois la guerre était considérée comme une chose bonne et sacrée. Il relève que parmi les saints de sexe masculin du calendrier russe, il n’y a pratiquement que des moines ou des princes, c’est-à-dire des chefs de guerre (citons par exemple saint Vladimir de Kiev, saint Alexandre Nevski, ou encore saint Dimitri Donskoï). Il en conclut que, parmi tous les métiers offerts aux hommes du siècle, celui des armes était traditionnellement considéré comme celui menant le plus surement à la sainteté. Mais il relève également que voilà qu’à présent la guerre est jugée barbare, mauvaise, la pire chose que puisse engendrer la folie humaine, et que la profession des armes est dite chose vile, moralement ignoble, indigne d’un homme civilisé. Le général rajoute que seule la certitude de faire œuvre bonne et sacrée peut soutenir le soldat qui accepte de tuer et d’être tué. Il craint que sans cette conviction, le métier des armes ne puisse plus attirer effectivement que des hommes motivés exclusivement par leur cupidité ou par leur goût pour la violence, bref la lie de l’humanité à ses yeux.
Mais l’homme politique se gausse quelque peu de cette dénonciation de l’antimilitarisme. L’important n’est pas selon lui de se demander si la guerre est chose bonne ou mauvaise, mais de la replacer dans la perspective du progrès historique. La guerre est probablement un mal, mais aussi un mal nécessaire, et parfois même pourrait-on rajouter un moindre mal. Il n’est pas étonnant qu’aux époques antérieures, il ait ainsi fallu sanctifier la guerre. Mais dans le temps présent marqué par le progrès des nations, la guerre est vouée à être peu à peu remplacée par de nouveaux moyens de résolution pacifique des conflits, au fur et à mesure que s’étendra la sphère d’influence de la civilisation européenne. L’homme politique se revendique lui-même de la bourgeoisie européenne, libérale et éclairée (et fermement colonialiste). Il estime impossible que l’Europe puisse connaître à nouveau une guerre majeure, et pense que celle-ci va devenir bientôt un espace tout à fait pacifié, régulé par le droit international.
Soloviev n’est pas réactionnaire, il ne croit pas que le progrès occidental soit intrinsèquement et totalement mauvais (il débattra sur ce point avec Constantin Leontiev). Mais il ne peut cependant rejoindre l’optimisme quelque peu béat de l’homme politique. Le mal n’est pas juste un archaïsme, le résidu d’une époque primitive voué à être éliminé par les projets d’ingénierie sociale de la bourgeoisie progressiste. Il est une force cosmique. Et l’Occident « éclairé » lui semble en réalité bien peu armé pour lui résister. En effet, le progrès occidental est aux yeux de Soloviev avant tout un progrès relevant de l’ordre matériel, et en cela il est d’ailleurs digne d’estime. Mais il s’accompagne d’un déclin de l’ordre spirituel. La conjonction de ces deux phénomènes, accroissement de la puissance matérielle et décroissement de la puissance spirituelle, finira assurément par provoquer de très grandes catastrophes. Le XXe siècle s’annonce ainsi aux yeux de Soloviev, et contrairement à l’optimisme de l’homme politique, comme un siècle de fer et de feu.
Le prince défend quant à lui un pacifisme radical. La guerre est pour lui un mal absolu, toujours et partout. Les guerres du passé sont tout autant immorales et condamnables que celles présentes ou à venir. Le Christ a totalement proscrit la violence, et nous a enseigné que répondre au mal par le mal ne faisait que l’entretenir et le renforcer. Ainsi, seul le respect du principe de non-résistance au mal permettra de briser le cercle de la violence dans lequel est enfermée l’humanité. On le voit, le prince est un disciple de la pensée de Léon Tolstoï. À l’instar du grand écrivain russe, il ne croit pas que le Christ soit le Verbe incarné, pas plus qu’il ne croit à la résurrection pascale ou à n’importe quel autre miracle. Il professe un déisme spiritualiste, pour lequel Jésus est un maître de morale dont le cœur de l’enseignement est le principe de non-résistance au mal.
Au prince, Soloviev répond simplement qu’il est faux que toute guerre soit un mal. L’histoire nous apprend en effet qu’il y a des guerres bonnes, et des paix mauvaises. L’erreur fondamentale du prince est de ne considérer le problème qu’à travers un rapport binaire : entre le belliciste qui frappe la joue droite, et le pacifiste qui tend la joue gauche. Or, relève Soloviev, la guerre engage parfois un rapport en réalité ternaire : entre l’agresseur qui s’en prend au faible, le faible qui est victime de l’agresseur, et le protecteur qui vient prendre la défense du faible les armes à la main. Dans cette situation (peut-être rare dans les faits, mais qui arrive néanmoins), la guerre faite par le protecteur à l’agresseur est évidemment bonne et juste. Pour Soloviev, l’accomplissement du bien est toujours une œuvre divino-humaine qui exige la participation active de l’homme, y compris par les armes. Refuser de résister au mal au nom d’un pacifisme de principe comme le préconise le prince, c’est finalement laisser au diable la liberté de se déchaîner.
La nature de l’Antéchrist
On le voit, Soloviev rejette à la fois le matérialisme de l’homme politique, culte de l’homme sans Dieu, et le spiritualisme du prince, culte de Dieu sans l’homme. À l’un comme à l’autre, il reproche finalement de ne pas reconnaître la vérité du Dieu-Homme, le Christ. En effet, l’homme politique et le prince ont en commun de ne voir le mal que comme un manque, un manque de progrès pour le premier et un manque de moralité pour le second, et du coup de ne pas le reconnaître dans toute sa terrifiante puissance. Pour Soloviev, le mal « ne s’exprime point par la seule absence de bien mais par une opposition, une prédominance positive des forces inférieures sur les forces supérieures dans tous les domaines : le mal individuel, public, physique, et finalement le mal suprême et qui les enveloppe tous, la mort. » La mort, conséquence héritée du péché ancestral selon la Tradition orientale (et non culpabilité héritée comme pour une part de la Tradition occidentale), est donc la manifestation suprême du mal. Mais la vérité du Christ, c’est bien celle d’une victoire eschatologique de la vie sur la mort, et donc du bien sur le mal, par la résurrection finale, garantie par un évènement historique (pour Soloviev) : la résurrection pascale du Dieu-Homme. En refusant le miracle de la résurrection du Christ comme ils le font, l’homme politique et le prince acceptent finalement le triomphe définitif et irrémédiable du mal.

Toutefois, Soloviev ne renvoie pas l’homme politique et le prince dos à dos. Le progressisme finalement assez pragmatique de l’homme politique n’est pas en effet totalement dénué de valeur à ses yeux. C’est par passivité avant tout, à cause de la grossièreté de son sécularisme, que l’homme politique accepte le triomphe du mal. Le prince lui, en prêchant la non-résistance au mal, prêche activement en vérité la soumission au diable. Soloviev n’oublie pas que pour la Tradition biblique et patristique (par exemple chez saint Cyrille de Jérusalem), l’Antéchrist est bien une figure de l’imposture religieuse, et non séculière. L’Antéchrist est un pseudo-Christ, un imposteur qui affirme accomplir l’Évangile, alors qu’il le détourne et le corrompt. Or c’est bien ce que fait en substance le prince, en affirmant que le cœur de l’Évangile est la non-résistance au mal, et non cette résurrection pascale à laquelle il ne croit pas. Aux yeux de Soloviev, le tolstoïsme (et toute pensée y correspondant) pave ainsi la route à la venue eschatologique de l’Antéchrist.
Les Trois entretiens sur la guerre, la morale, et la religion s’achèvent sur une nouvelle racontant la venue et la défaite finale de l’Antéchrist. Ce récit apocalyptique exprime ainsi la dernière mise en garde du philosophe. Contrairement à ce qu’essaie de nous convaincre le cinéma d’horreur américain (qui, même hollywoodien, demeure toujours puritain dans l’esprit), le mal radical n’est pas monstrueux, maléfique de façon obvie. Il est la falsification du bien. À l’image de l’Antéchrist, le mal radical accomplit son oeuvre en nous faisant croire qu’il accomplit le bien. Étonnante préscience de Soloviev, qui semble ainsi discerner par avance ce qui sera le cœur du mensonge soviétique. Si l’ampleur des falsifications sataniques du XXe siècle, et du XXIe aussi d’ailleurs, fait peut-être paraître Soloviev quelque peu sévère avec Tolstoï, elle prouve également la vérité de cette dernière mise en garde : le mal est d’autant plus profond quand il est l’illusion du bien. « Satan lui-même se déguise en ange de lumière », nous prévenait déjà saint Paul (2 Co 11.14).