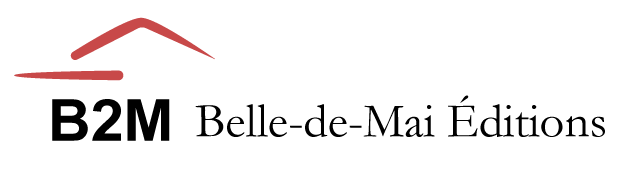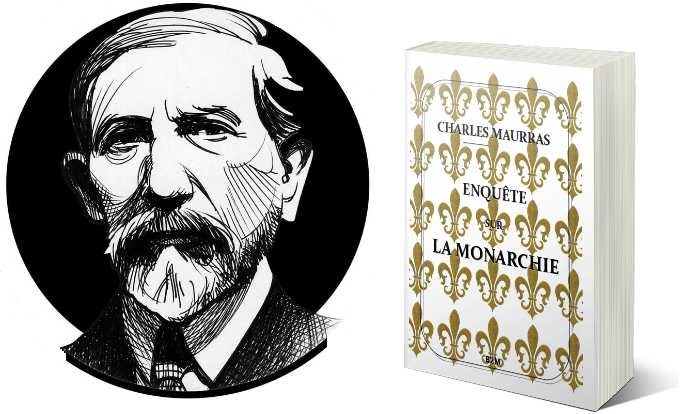Toujours d’actualité, comme tout classique
- Rémi Hugues
- 31 octobre 2020
- 3234 visites
Chronique de Rémi Hugues
LʼEnquête sur la monarchie nʼexiste pas. Cʼest par cette entrée en matière un brin provocante quʼil paraît nécessaire de présenter ce qui est plus un titre quʼun essai, tant les versions ont été nombreuses, au gré des desiderata des éditeurs.
Lʼédition originelle a été publiée non sous forme de monographie, mais de feuilleton, dans la Gazette de France, il y a 120 ans, de juillet à novembre 1900.
Puis se sont ajoutées à ce qui est, comme son titre lʼindique, une enquête – et qui nʼa donc rien à voir avec un ouvrage de type universitaire exposant un raisonnement dont les articulations seraient fondées sur la méthode de la dissertation classique –, présentations, préfaces, lettres de réponse, textes additionnels, comme « Dictateur et roi », publié trois ans plus tard, le 1er août 1903.
LʼEnquête est donc un « O.L.N.I. », un objet littéraire non identifié. Ce qui nʼenlève, bien évidemment, rien à ses mérites. Elle est un truchement particulièrement performatif pour celui qui cherche à convaincre autour de lui que le retour du Roi est pour la France un impératif de salut public, une nécessité sociale et politique.
LʼEnquête est dʼabord une apologie du principe dynastique, élément consubstantiel à la royauté.
Elle explique en outre avec lucidité et dans un esprit de synthèse ce qui a précipité sa chute. Troisièmement, elle est un réquisitoire contre un système qui existait déjà en 1900 et qui dure toujours, la démocratie libérale.
Ensuite, elle étudie les rapports entre monarchie et socialisme, apportant de précieux renseignements en matière dʼhistoire des idées politiques, renseignements nécessaires afin de briser le néfaste dualisme gauche / droite, qui dʼailleurs est de moins en moins opérant, pour ne pas dire moribond.
Enfin, LʼEnquête revêt une dimension purement heuristique : cʼest aussi une leçon dʼépistémologie de sociologie historique, qui souligne que la famille est cruciale comme instance de détermination du changement social et politique, proposant une alternative au débat qui oppose les tenants de lʼhistoire-faite-par-les-grands-hommes contre ceux de lʼhistoire-faite-par-les-masses.
Cette étude vise à permettre au lecteur royaliste pressé de revenir aux fondamentaux de la pensée de Charles Maurras, de revenir sur les arguments cardinaux que ce dernier a développés pour justifier sa conversion profane au régime dʼavant 1789, sa rupture avec la Révolution et sa « religion républicaine » dont parlait le journaliste dreyfusard Joseph Reinach, sa sortie dʼune « matrice » qui illusionne 120 ans plus tard toujours autant de monde.
Les Capétiens, ou lʼillustre Maison de France
Soyons honnêtes : à lʼorigine la naissance monarchie française est une affaire de grand remplacement. De grand remplacement non par la masse, par la base, mais par le haut. Aux élites politiques résultées dʼune hybridation entre lʼenvahisseur romain et lʼautochtone gaulois se sont substituées une race conquérante venue des Bouches-du-Rhin. En France, référence mondiale de la gastronomie aussi bien que de lʼart de lʼéloquence, tout est histoire de bouches. Plus tôt, le christianisme sʼétait introduit à partir dʼautres bouches, celles du Rhône.
Les Francs, via Clovis, adoptèrent la religion nouvelle, et purent faire souche au sein de ce pays dont on dit parfois quʼil est au Nouveau Testament ce que la Judée fut à lʼAncien. Ce qui expliquerait pourquoi nous sommes une nation dʼécrivains.
Dont Charles Maurras : qui, au lieu de traiter de lʼensemble des familles royales franques, insiste sur la monarchie capétienne. Ainsi note-t-il : « Parce que les Caroligiens nʼassuraient pas la sûreté du territoire et des populations contre Bulgares et Normands, ils cédèrent la place à nos Capétiens. Parce que les Capétiens protégeaient efficacement, lʼonction du sacre est logiquement venue sur leur front. »1 Une lutte interne opposait ces élites franques, ce qui nʼest pas sans rappeler la théorie de Vilfredo Pareto, à laquelle se confronte la vision pré-marxienne du comte Henri de Boulainvilliers et dʼAugustin Thierry, qui pose que le conflit central résidait entre Francs et Gaulois.
Cʼest au fond peut-être par une double dialectique (élites établies / élites de remplacement et gouvernants / gouvernés) que ce « grand dessein territorial et national »2 quʼest la France est né. Et Maurras de convoquer son grand ami, si ce nʼest son grand frère, ou même son mentor, Frédéric Amouretti, avec qui il partageait, dit-il, cet avis :
« Citoyens, on vous a raconté que nos rois étaient des monstres : il y eut parmi eux, c’est vrai, des hommes faibles, peu intelligents, plusieurs médiocres, débauchés, et peut-être deux ou trois méchants. Il y en eut qui fussent des hommes remarquables, la plupart furent des hommes d’intelligence moyenne et consciencieux. Regardez leur œuvre : c’est la France. »3
Une telle approche conséquentialiste amène à sʼinterroger sur les raisons de la réussite évoquée, de la grandʼœuvre accomplie. Cela est son corollaire.
Le premier grand mérite du principe dynastique, dʼaprès Maurras, est sa capacité à dégager une élite – au sens fort du terme, cʼest-à-dire légitime –, qui doit être la véritable force motrice de la nation. Sans monarchie, pas dʼartistocratie : « Ainsi le mode de gouvernement qui, à première vue, semble exposer le peuple au hasard du règne incapable est le seul qui lʼen délivre le plus souvent… […] Le monarque héréditaire nʼa pas science infuse des hommes et des choses, ni sens infus de lʼart du gouvernement : il est le mieux placé pour sʼentourer des hommes qui possèdent ce sens et cette connaissance, sʼil nʼest pas le plus mal placé pour recevoir de la nature ou pour obtenir de la tradition et de lʼéducation quelques-uns de ces dons précieux. »4
Ainsi Maurras considère que la fonction sociopolitique du Roi est la suivante : « Son véritable office propre est de convier lʼélite de sa génération à collaborer avec lui pour un progrès dans lʼordre qui obtienne lʼassentiment pratique de la quasi unanimité du pays. »5
Les électeurs, quant à eux, sont incapables dʼassurer aux meilleurs de chaque génération lʼobtention de lʼéminente place qui leur revient. Il est plus aisé de prodiguer une instruction de haute qualité à un seul homme plutôt quʼà tout un peuple.
Maurras écrit : « Bien rares ont été ceux qui nʼont fait quʼun saut du berceau au trône. Si le hasard de la naissance semble mettre la couronne à la loterie, ni plus ni moins que le hasard de lʼélection, une préparation peut être donnée à lʼhéritier par lʼéducation : est-ce que lʼélecteur la reçoit ? Et lʼhéritier apporte, sans avoir à lʼapprendre, cette connaissance expresse ou diffuse, cette tradition, quʼil reçoit de ses parents et de lʼatmosphère de sa famille. »6
Ici est souligné que lʼinstance de socialisation primaire la plus décisive en ce qui concerne la transmission du savoir est la famille, et non lʼécole.
LʼÉcole de la République prétend former des citoyens en vue de décider collectivement du Bien commun. Le hasard de la naissance, dʼautant plus que Lamarck montra que le milieu compte autant que les gènes, est bien plus réduit que le hasard conduisant à la victoire de tel ou tel candidat. Lʼélection est souvent une grande loterie où tout se joue sur un sourire, un timbre de voix ou la beauté des costumes de lʼimpétrant. Mais surtout elle nourrit une lutte permanente pour les places, au détriment de lʼintérêt supérieur de la nation. Ce qui compte, cʼest la réélection. Ce qui prime, et ce de façon permanente, cʼest la compétition.
À cet égard ce que fait remarquer Maurras doit être relevé : « Lʼhérédité souveraine est un bien en soi : sans égard à la personne de lʼhéritier, cette façon de succéder anéantit la querelle, fonde la paix, maintient uni ce qui disperse la compétition. […] Les Français ne seraient pas hommes, affectueux et raisonnables, si la race royale qui a fait leur nation ne recevait point dʼeux le culte dʼestime et dʼamour quʼun si grand bienfait leur réclame. Un lien moral unit la France à la série des chefs fondateurs quʼil faut bien appeler pères de la patrie. »7
La patrie, justement, est unifiée par le roi. Les dynasties royales maintiennent lʼunité sociologique – on vient de le voir – mais aussi géographique de la patrie. Contempteur du jacobinisme, Maurras voyait dans la centralisation non seulement une perte de substance nationale mais surtout une mouvement paradoxal de dislocation du pays. Cʼest la diversité qui fonde lʼunité. Elle en est la condition de possibilité. Sinon, il y a lʼuniformité, qui est un facteur de dissolution.
Sur ce point, Maurras indique que lʼ « effort décentralisateur est une pièce indispensable de la refonte générale. Le lien national doit être retrempé, et retendu à ses sources : la province, le pays, la ville, le village, le foyer. Il faut rendre aux clochers de nos hameaux comme aux acropoles de nos provinces un pouvoir de vie autonome qui les régénère.
La France est une fédération historique faite autour du fédérateur parisien. Cet élément fédérateur est précieux à tous les égards, il ne doit ni entraver ni sacrifier les éléments fédérés. […] Cʼest par la conscience et lʼamour de nos plus humbles commencements engagés dans la paroisse, la petite ville, le quartier de la grande ville, que peuvent et doivent renaître la conscience et lʼamour du composé national entier. […]
Le patriotisme français se perdait dans lʼabstraction juridique et dans la bureaucratie chère aux démocraties. Mistral et le félibrige, les barrésiens de lʼEst, ceux de lʼOuest, notamment le groupe breton avec Le Goffic et ses amis, ont retrouvé la substance concrète qui fait lʼaliment et le stimulant de toute dialectique nationale lorsque, partie dʼun point quelconque de temps ou de lʼespace, de lʼhistoire ou du territoire, elle aboutit à la capitale, à lʼÉtat. »8
Heurs et malheurs de notre royauté
À propos de lʼhistoire administrative de la France, il est loisible dʼinvoquer Alexis de Tocqueville et son essai LʼAncien régime et la Révolution, dans lequel il met en évidence que cʼest précisément la monarchie capétienne, tant vantée par Maurras, qui aurait inventé la centralisation étatique, et non les révolutionnaires jacobins. Il y aurait donc contradiction entre lʼéloge quʼil fait des Capétiens et son positionnement favorable à la décentralisation.
Pierre de Meuse, dans son précieux Idées et doctrines de la Contre-révolution relate cet épineux problème ainsi :
« [T]out lʼeffort de la monarchie a été au long des siècles de centraliser afin de permettre à lʼÉtat dʼavoir une action sans entraves. À ce titre, la Révolution française ne serait pas une rupture avec la politique antérieure, mais sa continuation. Même Maurras en vacille sous le coup ! Et il le reconnaît : oui les rois de France ont centralisé, mais, nous dit-il, ils laissaient cependant subsister des entités capables de se défendre alors que le pouvoir républicain les anéantit ; de plus le pouvoir royal nʼétait pas idéologique, et ne cherchait pas à remodeler le pays. Certes, cʼest indiscutable. Mais ce que Maurras répugne à admettre, et que Julien Freund et Bertrand de Jouvenel nous expliquent, cʼest que lʼÉtat est naturellement centralisateur. Pire encore, la rationalité étatique se nourrit de lʼordre social quʼelle dissout à mesure quʼelle instrumentalise ses organes. »9
Quoi quʼil en soit, il y a de toute façon dans LʼEnquête une évaluation des erreurs commises par les rois capétiens. Ce nʼest pas leur hagiographie, mais leur biographie, si lʼon peut dire.
On notera la lettre-réponse de Frédéric Amouretti à son camarade et ami Maurras, qui donne sur ce thème des éclairages des plus intéressants :
« La période de déviation nationale a commencé au milieu du dix-septième siècle avec Mazarin ; Louis XIV nʼa plus convoqué les États généraux ; il a établi la capitation par ordonnance, il a érigé les charges municipales en titres dʼoffices. Ainsi il supprimait la représentation nationale. »10
Puis, poursuit-il : « Les Capétiens directs, les Valois, si indignement calomniés, les deux premiers Bourbons ont réalisé le type de la Monarchie tempérée, qui a dʼabord fait notre pays morceau à morceau, puis lʼa rendu le plus grand du monde. On se trompe quand on attribue à la dictature de Richelieu la déviation funeste qui sʼest produite après lui. »11
Selon Amouretti, cʼest à Louis XIV et non à Richelieu que revient la faute, la faiblesse dʼavoir succombé à la démesure : « Je suis convaincu dʼune façon très précise que cʼest Richelieu qui a marqué lʼapogée de la gloire française. Homme dʼÉglise, le grand cardinal était de petite noblesse, bien près encore du tiers état, semble-t-il ; il se rattachait donc aux trois classes. Prince par la pourpre romaine, il sʼinclinait cependant devant son roi, Louis XIII, cet excellent roi, homme admirable dʼénergie et de désintéressement ; le grand cardinal, obligé de se subordonner à un chef héréditaire, était protégé contre le vertige de la toute-puissance, si dangereux. Il mit la France si haut quʼaprès lui elle ne devait plus que décroître. »12
À la Monarchie absolue dont la figure la plus emblématique fut Louis XIV, Amouretti oppose une autre forme, censée être le modèle absolu de la future royauté française : « Seule […] la Monarchie tempérée peut donner à la France la sécurité par lʼarmée, la réputation par la diplomatie, la prospérité par la paix économique, et la reprise de la conscience nationale par la mise en valeur de toutes les énergies locales. »13
Malgré ses quelques défauts, qui probablement ont constitué la faille dans laquelle se sont insérés les ennemis de la Maison capétienne pour la renverser du trône, celle-ci représente un modèle à suivre : son règne correspond à lʼapogée de la France, située peu ou prou à lʼère dite du classicisme.
Sa prudence et sa modération furent sans doute les premières de ses vertus. Maurras avance : « Ses princes se sont appliqués, dʼun règne à lʼautre, à ne point trop gagner dans une seule entreprise, de crainte de trop perdre ultérieurement comme il est arrivé des Napoléon. Mais, à la différence de Napoléon Ier et de Napoléon III, qui tous deux laissèrent la France plus petite quʼils ne lʼavaient trouvée, les descendants dʼHugues Capet ont tous transmis leur héritage tel quʼils lʼavaient eu de leurs devanciers ou augmenté de quelque province. »14
Pas à pas la maison de France a édifié une nation à la mesure de ses ambitions. Après plusieurs siècles cette maison était à la tête de la « Chine de lʼEurope », de la « Grande Nation », rien de moins. Finalement son dessein a été, plutôt que de ressusciter lʼEmpire romain, de faire coïncider ses frontières avec celles de la Gaule.
Tel fut le pacte tacite passé entre Francs et Gaulois : ces derniers consentirent implicitement à la domination de ceux-là en échange de la réalisation de ce quʼils nʼétaient jamais parvenus à accomplir, à savoir lʼunité gauloise. Si lʼon reprend la terminologie dumézilienne, la France est la combinaison harmonieuse des bellatores – les Francs –, des oratores – Rome – et des laboratores – les Gaulois.
Et lʼon peut penser que ce qui conduisit Maurras à devenir royaliste, cʼest quʼil sʼaperçut vite que cette sublime réalisation irait à sa perte si la République, fille de la Révolution et donc dʼessence démocratique et libérale, sʼinstallait durablement sur le sol français.
LʼEnquête nʼest pas seulement une apologie de la royauté. Elle est aussi le procès en règle de la démocratie libérale.
La pensée « lib-dém », voilà lʼennemie !
La charge lancée par Maurras dans LʼEnquête contre la démocratie libérale est avant tout dʼordre institutionnel. Il explique que « lʼidée démocratique, et sa complémentaire lʼidée libérale, peu consistantes dans leurs thèses, diviseuses et débilitantes dans leurs effets, poussent à disperser lʼÉtat dans la vie sociale au lieu de le concentrer dans sa fonction naturelle, déterminant ainsi un énervement national qui facilite lʼentreprise de voisins plus pauvres et plus ambitieux. »15
Maurras voit très nettement dans la démocratie libérale un vecteur dʼaffaiblissement de la France, via dʼabord lʼaffaiblissement de lʼÉtat. En voulant se mêler de tout, lʼÉtat libéral-démocratique en vient à perdre sa capacité à assurer avec succès sa mission principielle : paix intérieure (sécurité et justice) et diplomatie (guerre et paix).
Et cet État libéral-démocratique, qui semble être animé par « la ferme résolution dʼaffaiblir, de diminuer, de détruire lʼÉtat dans lʼexercice de son plus juste droit régalien »16 est autant monarchique que républicain.
Dans un extrait du texte « Les Monod peints par eux-mêmes », paru le 1er janvier 1900 dans LʼAction française, Maurras nʼest pas tendre avec la Restauration :
« Cʼest sur la fonction propre de lʼÉtat que sʼacharnèrent les libéraux. Ils nʼattaquèrent ni lʼenseignement de lʼÉtat, ni lʼassistance publique dʼÉtat, ni les autres administrations dʼÉtat, mais bien le pouvoir de lʼÉtat sur les grands sujets de la politique étrangère et intérieure, ce quʼon doit appeler le pouvoir propre de lʼÉtat. […] Ils prônèrent lʼÉtat césarien, envisagé comme gendarme et pourvoyeur de la démocratie, comme marchand, comme hospitalier et maître dʼécole, comme administrateur et curateur universel. »17
Alors quʼil prétend se préoccuper des plus démunis, en réalité cet État se charge de défendre le fort au détriment du faible. Il nʼest plus un arbitre, mais un maton. Maurras souligne que « notre État est sans force, nos citoyens isolés sont à la merci, dʼabord de lʼAdministration, ensuite de toute autre collectivité solidaire »18, autrement dit de tout lobby, ou groupe de pression.
Ce que, de surcroît, Maurras reproche à lʼÉtat libéral-démocratique, cʼest son incapacité à faire converger intérêts du gouvernement et intérêt du gouverné. En liant le sort du roi à celui de sa nation, le principe dynastique, avance-t-il, est hautement estimable, dans la mesure où il force le souverain à prendre la bonne décision, car autant lui que son peuple aura à lʼassumer si elle sʼavère désastreuse ou ruineuse.
Que ce soit lʼÉtat sous la Restauration ou celui sous la République, il consiste, soutient Maurras, au règne de lʼétranger. Cet État que lʼon pourrait qualifier de « moderne » – au sens négatif du terme – dissocie radicalement les intérêts du gouvernement et ceux du gouverné.
La modernité nʼest-elle pas affaire de séparation, dans son acception hébraïque satan ou grecque diabole ? Lʼhistorien Augustin Thierry considérait à cet égard que la modernité est « la société nouvelle qui sépare lʼÉglise et lʼÉtat, le devoir social des choses de la conscience, et le croyant du citoyen. »19 On retrouve ce fil conducteur de la dislocation, très présent chez Maurras, en particulier lorsquʼil vilipende les « trois R » (Réforme, Révolution, Romantisme) : la modernité serait ainsi le triomphe de ce qui sépare, lʼère du tri entre le bon grain et lʼivraie.
La modernisation – au sens de démocratisation – de la France, dit en substance Maurras, signifie un processus de dépossession de soi ; processus lié au phénomène de xénocratie.
Cette modernisation remplace lʼaristocratie par lʼoligarchie, laquelle, « de nature cosmopolite »20, « ne connaît que des intérêts financiers ou métaphysiques. »21 Elle correspond en fait à une véritable entreprise de colonisation : Maurras va jusquʼà affirmer que la République des Gambetta, des Ferry et des Waldeck-Rousseau nʼest « que lʼexpression dʼun protectorat accordé de Londres ou de Berlin à la domination des étrangers ou demi-étrangers de lʼintérieur. […] Les républicains qui conservent lʼamour de la France en viennent à désirer que cette oligarchie étrangère, jouant parmi nous et contre nous des ressorts de la démocratie, soit remplacée par une aristocratie ou par une bourgeoisie indigène. »22
Mais il est illusoire dʼimaginer que puisse émerger un tel groupe. Car Maurras signale que lʼorganisation principale de cooptation de la classe dirigeante républicaine est la franc-maçonnerie, dont la nature est transnationale, mais surtout qui, à la différence de lʼÉglise de Rome, entend abolir les frontières nationales, ce qui pour Maurras est totalement chimérique : « il nʼest point de cadre politique plus large que la nation. »23, note-il dans la préface de 1909.
Il établit ainsi un parallèle entre la franc-maçonnerie et lʼÉglise : « sa grande rivale, lʼÉglise catholique, dispose, elle aussi, dʼune organisation puissante et plusieurs espèrent ou craignent sa transformation en oligarchie directrice de la République. »24
LʼÉtat libéral-démocratique et républicain est aussi maçonnique. Le Maître de Martigues considérait que la « république en France, dans la France de 1880 et de 1900, appartient, de nécessité et par une sorte de droit, au parti maçonnique international. »25
La contre-Église spécifique à lʼÉtat « moderne » est la franc-maçonnerie, qui constitue son deep state, son « État-profond », pour reprendre un syntagme à la mode. Il faut mentionner ces lignes extrêmement intéressantes sur ce point :
« Si […] les rues sont balayées en hiver, arrosées en été ; si la poste circule ; si les impôts rentrent régulièrement ; si les conscrits sont enrôlés à terme fixe et congédiés au jour dit ; si les marchandises payent au port les taux indiqués par la loi ; si les préfets administrent, si les ambassadeurs traitent et négocient ; si, en un mot, les affaires courantes sont expédiées de telle sorte quʼil paraisse y avoir une France et que la République ait suffisamment lʼapparence dʼun gouvernement, soyez-en sûr, mon cher président, cʼest à lʼoligarchie maçonnique que nous le devons. Bien ou mal, elle a pris la succession des gouvernements réguliers. Bien ou mal, elle continue leurs fonctions indispensables. Elle dispose dʼun personnel éprouvé. Soutenue et conduite par la ploutocratie, elle supplée à lʼinstabilité constitutionnelle, elle crée une suite de desseins politiques et administratifs, elle fournit le minimum de continuité nécessaire. »26
Pour Maurras, la franc-maçonnerie sous la IIIème République jouait le rôle de syndicat central, de moyen de synergie, de vecteur essentiel permettant aux groupes élitaires mobiles, étrangers, de se fédérer et de coordonner leur action : « Par une rencontre historique pleine de sens, qui rend hommage à la loi naturelle des groupes sociaux, fussent-ils antisociaux, le recrutement de cette oligarchie fait une large part au normal et double facteur de lʼhérédité naturelle et de la tradition historico-religieuse.
Elle se recrute en effet chez les Juifs, les Protestants et les Métèques, syndiqués dans la Franc-Maçonnerie. Ma théorie des Quatre États confédérés, héréditaires souverains de la République, peut servir de contre-épreuve à la théorie de lʼhérédité dans la Monarchie, expression du bien national.
On peut dire aux républicains qui sont restés dʼesprit français : vous avez renversé vos chef-nés, fils de votre race ; vous subissez des chef-nés étrangers, ou dénationalisés, et qui vous dénationalisent vous-mêmes. »27
Maurras sʼinsurge contre lʼaliénation culturelle des élites dʼorigine française. Cela, outre le grand remplacement des gouvernants français par des gouvernants allogènes, participe dʼun phénomène global de dé-Francisation. Et, soutient-il, ce phénomène est perceptible par la masse de ses concitoyens. Il constate en effet que le peuple « tient en défiance croissante lʼeffort dʼune haute finance internationale qui, ayant dragué lʼor, capte lʼopinion au moyen de lʼor, et, au moyen de cette opinion serve, crée un régime qui asservit le pays »28.
La franc-maçonnerie occupe la fonction de réceptacle, dʼorgane réticulaire, de deux aspirations profondes, lʼune matérielle et lʼautre morale. Elle est le point de rencontre entre le financier et le métaphysique, où sʼeffectue un travail dʼinversion de la nature spirituelle de la France, le christianisme. Maurras écrit :
« Sa puissance date dʼun siècle. Paraissant toujours favoriser la politique de gauche, elle compte à son actif, elle montre comme autant de victoires gagnées tous les désordres révolutionnaires qui ont désorganisé et ensanglanté le pays. Elle crée de ce chef, en sa faveur, un grand et puissant préjugé. […]
[C]ette Maçonnerie sʼappuie dʼabord sur un groupement semi-ethnique de plus dʼun demi-million dʼhommes, les protestants : vieux de trois siècles, tenant au plus vif de la chair et de lʼâme, représentant les plus vivaces rancunes historiques, ce groupe nʼest pas un simple concours de volontés. Il signifie une manière dʼêtre, de penser, de sentir, conséquemment dʼagir. Par-dessus les formules quʼil invoque ou les décisions quʼil manifeste, le protestant français est incapable de ne point obéir à certaines voix profondes de lʼintérêt de son clan ou de sa tribu. […]
Mais lʼintérêt protestant ne règne pas seul dans les Loges. Il y rencontre pour se solidariser avec eux, selon la formule de Thiebaud, les intérêts juifs. Le monde juif, plus encore que le protestantisme, est un groupement naturel. Il sʼattribue chez nous tous les droits dʼune aristocratie. Il en exerce à quelque degré les fonctions, en ce quʼil ouvre et ferme la bourse. Entre juifs, il est à peine besoin de négocier les conditions dʼune entente. Leur accord est tout spontané sur les grandes questions qui intéressent la communauté judaïque, ou même la communauté française. […]
Il sʼy joint du reste un autre concours : cʼest le Métèque ou lʼétranger domicilié parmi nous ; cʼest la ploutocratie européenne si bien représentée à Paris ; cʼest enfin les gouvernements étrangers. LʼÉtranger, la grande Banque cosmopolite et les différents hôtes qui prospèrent sous notre ciel ont tous quelque intérêt à ce quʼaucun ferme pouvoir nationaliste ne rende à la France lʼorganisation, la vigueur et la discipline »29.
Mais, dissimulant cette arrière-boutique de la République quʼest la coterie maçonnique, la loterie des élections au suffrage universel est assimilable aux ombres de la caverne décrite dans le livre VII de La République de Platon.
Le parlementarisme nʼest quʼune façade, lʼattrape-gogos qui est là pour laisser croire aux catégories de gens les plus naïfs que la démocratie fonctionne, quʼelle est véritablement un moyen pour le peuple de se gouverner lui-même.
Maurras a la bonne idée de nous livrer les opinions politiques de lʼimmense Honoré de Balzac sur le parlementarisme. Dans « Du gouvernement moderne », paru le 1er décembre 1900 dans la Grande Revue, ce dernier remarque que le parlementarisme « ne sortira jamais de ce dilemme, cruel pour les résultats que certains esprits attendent :
Ou la nation sera soumise pendant longtemps au despotisme dʼun homme de talent, et retrouvera la royauté sous une autre forme, sans les avantages de lʼhérédité ; ce seront des fortunes inouïes quʼelle payera périodiquement. Ou la nation changera souvent de ministres. Et alors, sa prospérité sera physiquement impossible, parce que rien nʼest plus funeste en administration que la mutation des systèmes.
Or, chaque ministre a le sien, et il est dans la nature que le plus médiocre ait la prétention dʼen créer un, bon ou mauvais. […] Il arrive au pouvoir en voyageur, se tire de peine par un emprunt, grossit la dette et sʼen va souvent au moment où il sait quelque chose de la science gouvernementale… »30
Comme lʼun des autres maîtres incontestés de la littérature française, Charles Baudelaire ne goûtait guère aux chimères de la démocratie libérale et parlementaire, qui « dérive », soutient Maurras, « de la ʽʽrévolution bourgeoiseʼʼ de 1789 »31.
Ce quʼil y a de commun en outre entre ces artistes contre-révolutionnaires et le Maurras de LʼEnquête sur la monarchie, cʼest le souci accordé à la Justice sociale. À lʼépoque de sa rédaction, cʼétait sans aucun doute lʼenjeu politique surdéterminant. Cet ouvrage est aussi lʼoccasion de réfléchir à la question du rapport entre royalisme et socialisme.
Royalisme et socialisme
Dans la préface de 1909 à LʼEnquête sur la monarchie, Maurras ne manque pas de rappeler « les jeunes pensées anarchistes ou socialistes qui composaient le premier groupement de lʼAction française »32.
Ailleurs il loue La Cocarde de Barrès, « délicieux et merveilleux petit journal révolutionnaire » où « royalistes, bonapartistes, socialistes, anarchistes y fraternisaient »33.
Le socialisme fut dʼabord une réaction au triomphe du monde marchand, et de son corollaire, lʼindividualisme. Cette réaction produisit une volonté nouvelle, celle de recréer le lien social, qui était affecté par un délitement. Or pour cela il fallait identifier la raison profonde de cette cassure : la prise du pouvoir du paradigme des Lumières, autrement dit de la pensée libérale et démocratique.
Mais il connut une transformation importante lors de lʼaffaire Dreyfus, sous lʼégide de Jean Jaurès. Ce dernier voyait dans la République le régime naturel du socialisme, la structure institutionnelle idoine pour la démocratie, les deux dʼaprès lui devant aller de paire.
Maurras signale que Jaurès était bien seul à développer cette vision à lʼintérieur de sa famille politique.
« Quand le socialiste autrichien Kautsky remarqua, en 1903, que dans aucun pays il nʼa été répandu plus de sang ouvrier que dans la République française pendant les douze dernières années, nos journaux les plus avancés lʼapplaudirent étrangement.
Lʼannée suivante, au Congrès dʼAmsterdam, M. Jaurès qui présentait la défense de la République eut à souffrir un martyre cruel. ʽʽDans une certaine mesureʼʼ, lui disait Bebel, ʽʽje dois être lʼavocat de la Monarchie contre vous… La Monarchie ne peut sʼengager à fond dans la lutte de classe. Elle doit compter avec le peuple. Dans toutes les républiques, on constate lʼintervention des troupes pendant les grèves.
Le gouvernement français est lui aussi un gouvernement de classe.ʼʼ Lʼavocat de la République dut quitter cet âpre terrain des faits et se réfugier dans lʼapologie des mobiles démocratiques. Cette confusion de la politique et de la morale ne tourna point à lʼavantage de la thèse : si M. Jaurès invoquait la majesté du sufrage universel, ʽʽvous le tenez de Bonaparte ʼʼ, ripostait Bebel ; si lʼorateur célébrait la vertu de sa forme républicaine, ʽʽvous la tenez de Bismarck, qui a fait votre empereur prisonnierʼʼ, répondait lʼimplacable Germain.
Au surplus, M. Jaurès croyait-il beaucoup nuire à la Monarchie en alléguant quʼelle tendait au bien du peuple non par amour, non par devoir, mais ʽʽpar égoïsmeʼʼ, par ʽʽégoïsme intelligentʼʼ ? »34
Parmi les socialistes français, le grand rival de Jaurès, Jules Guesde, ne partageait pas non plus son inclination républicaine. Maurras note : « Lʼintervention de M. Guesde montra que son groupe était aussi étranger que la Social-Démocratie allemande aux sentiments républicains de M. Jaurès : ʽʽEn quoi, je vous le demande, la forme républicaine sauvée avancerait-elle lʼaffranchissement du prolétariat ? Quand vous aurez sauvé la République, vous nʼaurez rien fait pour le prolétariat. Si, pour elle, celle-ci doit abandonner ses intérêts propres chaque fois quʼelle est en danger, la République est le pire des Gouvernements.ʼʼ »35
Le néoroyalisme de Maurras nʼest pas réactionnaire – dans le sens de réaction bourgeoise et nobiliaire face aux masses ouvrières – mais entend réinstaurer le règne de la Justice sociale – ce syntagme étant de Louis XVI – de façon conséquente. Et, étonnamment, Maurras voit dʼun bon œil le socialisme radical, appelé syndicalisme-révolutionnaire. Ou en tant cas il le préfère au socialisme modéré – ou social-démocratie – quʼil voue aux gémonies.
Ainsi il regarde avec bienveillance le mouvement anarcho-syndicaliste, mettant en lumière que cette « école nouvelle, représentée par MM. Georges Sorel et Hubert Lagardelle, a déployé beaucoup dʼénergie et dʼesprit de suite à renouveler, à vulgariser les anciennes critiques de Proudhon et de Marx, de MM. Lafargue et Guesde à lʼégard de la ʽʽrévolution bourgeoiseʼʼ de 1789, de laquelle dérive le parlementarisme français.
La même école aura rendu tout à fait sensible lʼopposition qui existe entre le régime syndicaliste, établi sur un intérêt social commun, et le régime démocratique, fondé en droit sur la volonté ou lʼopinion de lʼindividu. Les rapides progrès du mouvement syndical ont charrié et propagé avec ce sentiment les idées les plus hostiles à la démocratie.
Celle-ci est traitée en ennemie prodonde. Le parti au pouvoir, bien quʼétiqueté radical-socialiste et recruté parmi dʼanciens profès du socialisme, était en outre obligé de défendre à coup de fusil les lois des Chambres élues et les décisions des bureaux centralisés contre lʼoffensive des syndicats confédérés.
Aussi les conducteurs de la masse ouvrière font-ils un pas de plus. Ils ne sʼen tiennent plus à viser le régime et le personnel du Parlement ou la législation démocratique. Ils dédaignent presque les hommes contre lesquels sʼéleva le plus de colères dans le monde des syndiqués, M. Clemenceau ou M. Briand : les plus révolutionnaires dʼentre les ouvriers parisiens ont pendu à la fenêtre de la Bourse du Travail le buste de la République elle-même.
Cette exécution mémorable, qui eut lieu place du Château-dʼEau, le lundi 3 août 1908, commençait la séparation des masses révolutionnaires et de lʼÉtat républicain. Elle renfermait ainsi des promesses que les événements nʼont pas cessé de tenir depuis. Pas une crise sociale qui nʼait accusé et confirmé, dʼun mois à lʼautre, cette haine raisonnée de la classe ouvrière contre le régime ; pas un conflit économique qui nʼait fini par mettre en cause les désordres dont ce régime est lʼexcitateur.
Or, par une coïncidence digne dʼadmiration, cʼest depuis le même temps quʼune fière jeunesse recrutée dans toutes les classes du pays se passionne pour les idées de la Monarchie et se dévoue à les répandre. Le groupe-né des Camelots du Roi y met tant de résolution que, en peu de mois, du Quartier latin pris pour centre aux extrémités du territoire, presque toutes les réactions du patriotisme ont eu lieu au cri de ʽʽvive le Roi !ʼʼ »36
Ces deux mouvements dont il observe le déploiement synchronique sont pour Maurras convergents. Les forces de la jeunesse et les forces du travail ont vocation à se rassembler et ce qui en découlera est la monarchie traditionnelle, héréditaire, antiparlementaire et décentralisée. Cʼest en filigrane lʼesprit du Cercle Proudhon qui se dessine.
Au lieu de le voir comme une force dissolvante, Maurras conçoit le syndicalisme comme un embryon de corporatisme moderne. Et le « Grand Soir » dont Sorel et les siens appelaient de leurs vœux nʼest plus tellement craint par Maurras, car il le comprend désormais comme relevant du mythos, et non comme le risque dʼun chaos futur. Il jugeait que Sorel sʼétait aperçu que pour mobiliser de la meilleure manière possible les masses il faut atteindre les inconscients collectifs.
Et par conséquent sa Révolution nʼest pas une fin mais un moyen, une image, un symbole : elle est un instrument visant à atteindre la « psychê collective » (Carl G. Jung) des travailleurs.
À cet égard, le mythe du « Grand Soir » peut être interprété comme une sécularisation des espérances eschatologiques dans le venue du Paraclet, du Christ-Pantocrator destiné à être le maître dʼun monde dʼoù tout Mal sera chassé, dʼoù toute servitude sera extirpée. En somme où la Justice régnera pour lʼéternité.
Commentant le chapitre XV de la Genèse, Saint Augustin écrivit que « la persécution de la cité de Dieu, telle quʼil nʼy en eut jamais auparavant et qui est espérée pour le règne futur de lʼAntéchrist, est représentée par lʼépouvante pleine de ténèbres dʼAbraham au moment du coucher du soleil, cʼest-à-dire aux approches de la fin du siècle ; de même, au coucher du soleil, cʼest-à-dire à la fin même du siècle, la flamme signifie le jour du Jugement, le jour de la séparation entre les hommes charnels qui doivent être sauvés par le feu et ceux qui doivent être damnés dans le feu. »37
On retrouve dans cette expression de « Grand Soir » un contenu apocalyptique, comme le souligne Gershom Scholem : « LʼApocalypse, chargée comme elle lʼest dʼune profonde haine des gouvernants de la terre et de la prostituée de Babylone – à savoir lʼEmpire romain – devint lʼun des livres les plus révolutionnaires de lʼhistoire de la littérature. »38
Revenons à quelque chose de plus profane : sʼil sʼagit dʼanalyser du point de vue sociologique ce qui distingue fondamentalement royalisme (tel que Maurras le construit en tant que système de pensée politique) et socialisme, on en arrive à lʼidée selon laquelle que celui-là met au pinacle une instance de socialisation secondaire – le monde du travail –, pendant que celui-ci érige une instance de socialisation primaire – la famille – en point primordial de la vie sociale et du moteur qui oriente les évolutions de celle-ci.
LʼEnquête contient effectivement une réflexion très poussée sur le rôle de la famille dans les affaires politiques.
Une sociologie politique de la famille
Pour conclure cette étude, nous nous intéressons à lʼimportance que revêt le principe dynastique dans le cadre du discours encomiastique du royalisme présenté par Maurras dans LʼEnquête.
On lʼa vu, avec la tradition, lʼantiparlementarisme et la décentralisation, lʼhérédité est lʼun des quatre piliers du modèle monarchique tel que Maurras le façonne dans ledit ouvrage. Et ce qui est le lieu de lʼhérédité, cʼest la famille.
En dépit de la rupture instituée par la modernisation des sociétés et des États, il subsiste dʼaprès Maurras cette permanence : « Si la nation est composée de familles, on se rend compte quʼune famille ou des familles la dirigent. »39 Il remarque en outre quʼ « un certain nombre de familles nobles et bourgeoises tranchent sur les autres en y perpétuant avec leur patrimoine, outre un sens national affiné, un vif esprit du service public, des habitudes de clientèle et de commandement local ou régional.
Où lʼindividu vivant de la politique était un intrus souvent dangereux, la famille qui fait de la politique sait ce quʼelle fait et par sa durée même témoigne quʼelle donne autant quʼelle reçoit. Elle ne dissimule pas sa fonction, elle la publie. Elle ne dit pas au peuple quʼil règne, ni gouverne, mais elle reconnaît quʼelle lʼadministre, le gouverne et ainsi le sert.
Caractérisées par lʼéducation reçue et transmise, par la tradition prolongée, par le rang moral maintenu, ces familles portent la charge, elles remplissent les devoirs, elles accèdent au pouvoir partiel ou total selon les pays. Ces éléments dʼaristocratie tendent-ils à la monarchie ? On le dit.
On se trompe. Cʼest tout le contraire. Si lʼon trouvait en France une forte charpente de ces familles stables, les chances seraient moins pour le gouvernement dʼun seul que pour la République aristocratique.
Mais on trouve autre chose en France : dans le nombre important mais très limité des familles seigneuriales ou capables de seigneurie, on trouve une race qui depuis mille ans les domine, les discipline, les conduit, les réduit au bien du pays.
Drumont lʼappelait la famille-chef. La situation de la famille-chef étant en rapport étroit avec les convenances de lʼintérêt national, le Droit national tend à prier cette famille dʼassurer la direction-en-chef du service public et à lui déférer ce commandement unique dont lʼesprit public accuse un besoin si aigu ! »40
En atteste, concernant la fonction déterminante de la famille dans lʼhistoire, outre les grands hommes ainsi que les masses, le rôle décisif joué par la dynastie des Capets-Bourbons-Orléans, cette « Race qui, en mille ans, a fait métier dʼopérer le rassemblement et la direction du pays. »41 Mais nʼest-il pas curieux, de la part du théoricien du nationalisme intégral, cet éloge de la « race internationale des Rois »42 ? Parce que la conduite politique de affaires dʼune nation relève autant du plan domestique que du plan mondial, nul nʼest plus adapté quʼune famille ayant des liens de sang par-delà les frontières. Comme le souligne Maurras, « la Monarchie héréditaire est le plus national et aussi le plus international de tous les pouvoirs »43.
Pour illustrer le caractère crucial de la famille dans le domaine sociopolitique, Maurras précise que « Napoléon se proposait précisément dʼaffaiblir les anciennes familles françaises afin dʼassurer sa domination et dʼaffermir lʼÉtat en constituant autour de lui une aristocratie héréditaire nouvelle. »44
Et mentionne un document faisant office dʼexemple pertinent, une lettre du 5 juin 1806 que Napoléon Ier adressa au roi de Naples, Joseph Bonaparte :
« Je veux avoir à Paris cent familles, toutes sʼétant élevées avec le trône et restant seules considérables, puisque ce ne sont que des fidéicommis, et que ce qui ne sera pas à elles va se disséminer par lʼeffet du Code civil. […] Voilà le grand avantage du Code civil. Il faut établir le Code civil chez vous. Il consolidera votre puissance, puisque par lui tout ce qui nʼest pas fidéicommis tombe, et quʼil ne reste plus de grandes maisons autres que celles que vous érigerez en fiefs. »
Cette thèse-maîtresse de lʼécole maurrassienne dʼaprès laquelle les Rois ont fait la France implique par conséquent une conception sociologique originale, mais, au-delà, elle constitue la substantifique moelle du discours de LʼEnquête. En voici un condensé fort utile :
« Les souvenirs de Rome ont fait lʼunité italienne. La réalité de la race et de la langue germaniques, unie aux traditions de Charlemagne et du Saint-Empire, a fait lʼunité allemande. Lʼunité britannique est résultée de la condition insulaire.
Mais lʼunité française, œuvre de politique, de la plus souple, de la plus longue et de la plus ferme politique autoritaire, résulte exclusivement des desseins continués pendant 1 000 ans par la Maison de France.
Cette unité, si solide quʼelle semble aujourdʼhui spontanée et naturelle, est lʼœuvre unique de nos princes. […] Bien que partie dʼun certain point du pays, cette dynastie populaire et militaire sʼest peu à peu étendue jusquʼaux confins de lʼancienne Gaule ; sa tradition sʼest amalgamée à toutes les nôtres. »45
Et lʼargument qui nous semble le plus décisif pour poser la supériorité de la royauté sur tout autre régime sʼappuie sur la réalité du principe dynastique, et donc de la famille, de la loi de lʼhérédité :
« Que le pouvoir suprême soit concentré en une famille ou réparti entre plusieurs, le régime dʼhérédité a pour effet premier de nationaliser leur pouvoir. La dynastie régnante ou, si elles sont en nombre convenable, les familles prépondérantes, étant unies étroitement, par leur intérêt propre, aux plus profonds intérêts de lʼÉtat, cherchent, sans doute, comme tout ce qui est humain, leur intérêt particulier : mais, en le trouvant, elles trouvent en outre et en même temps lʼintérêt général. »46
Rien, pas même le rouleau compresseur de la modernité, ne saurait anéantir cette institution sociale fondamentale quʼest la famille. Et si le journaliste de Challenges Bertrand Fraysse se plaint que le « mythe » des 200 familles perdure47, va-t-il ensuite sʼindigner de la thèse suivant laquelle les XVIIème et XVIIIème siècles virent les Maisons Habsbourg et Bourbon dominer le monde ?
Belle-de-Mai Éditions vient de rééditer L’Enquête sur la monarchie (version de 1900).